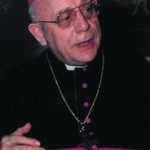Les évêques de Versailles et le Concile Vatican II
Mgr Renard, évêque au moment du Concile, puis Mgr Simmoneaux à sa suite, ont contribué à la mise en œuvre des décisions et orientations du Concile dans notre diocèse.
Conseil presbytéral, engagement des laïcs dans la catéchèse, développement du catéchuménat en sont des exemples.
Vœux d’unité et de mission
Dans notre diocèse, à l’époque du Concile, l’évêque était Mgr Renard, installé à Versailles depuis 1953. Il participa activement à ce Concile et y fit plusieurs interventions. Dans la suite du Concile, il créa le 10 février 1967 le conseil presbytéral (conseil de prêtres représentant l’ensemble des prêtres d’un diocèse auprès de l’Évêque). Ses deux vœux, lors de ses adieux à la Cathédrale Saint-Louis le 17 juin 1967, soulignait l’esprit du Concile qui venait de se dérouler. Un vœu d’unité : « en ce temps d’après-Concile, nous souffrons de trop de divisions entre catholiques » et un vœu de mission : « La croissance du Royaume de Dieu par votre témoignage…C’est dans cette perspective essentiellement apostolique qu’il faut saisir tout le renouveau authentique voulu par le Concile »
Une aventure de la foi au Christ
A sa suite, Mgr Simonneaux est celui qui a mis en œuvre les décisions et orientations du Concile. Convocation et mise en route du conseil presbytéral, création de conseils pastoraux locaux, d’un conseil diocésain des affaires économiques, appel à la collaboration des laïcs dans des postes de gestion et de responsabilité (économe diocésain, responsable diocésaine de pastorale sacramentelle et liturgique), engagement des laïcs dans la catéchèse et les aumôneries des lycées, développement du catéchuménat, restauration du diaconat permanent et de l’Ordo Virginum (vierge consacrée), mise en route de formation pour les laïcs, accueil de courant du renouveau charismatique. Au cours de la dernière messe chrismale qu’il concélébra, le 29 mars 1988, il concluait ainsi ses 21 ans d’épiscopat dans notre diocèse : « Ma confiance en Dieu pour l’avenir de notre diocèse n’est pas dans l’immobilisme, mais dans l’aventure. Une aventure de la foi au Christ qui nous a tous consacrés par l’onction pour porter la bonne nouvelle du salut. Avancez au large ! »